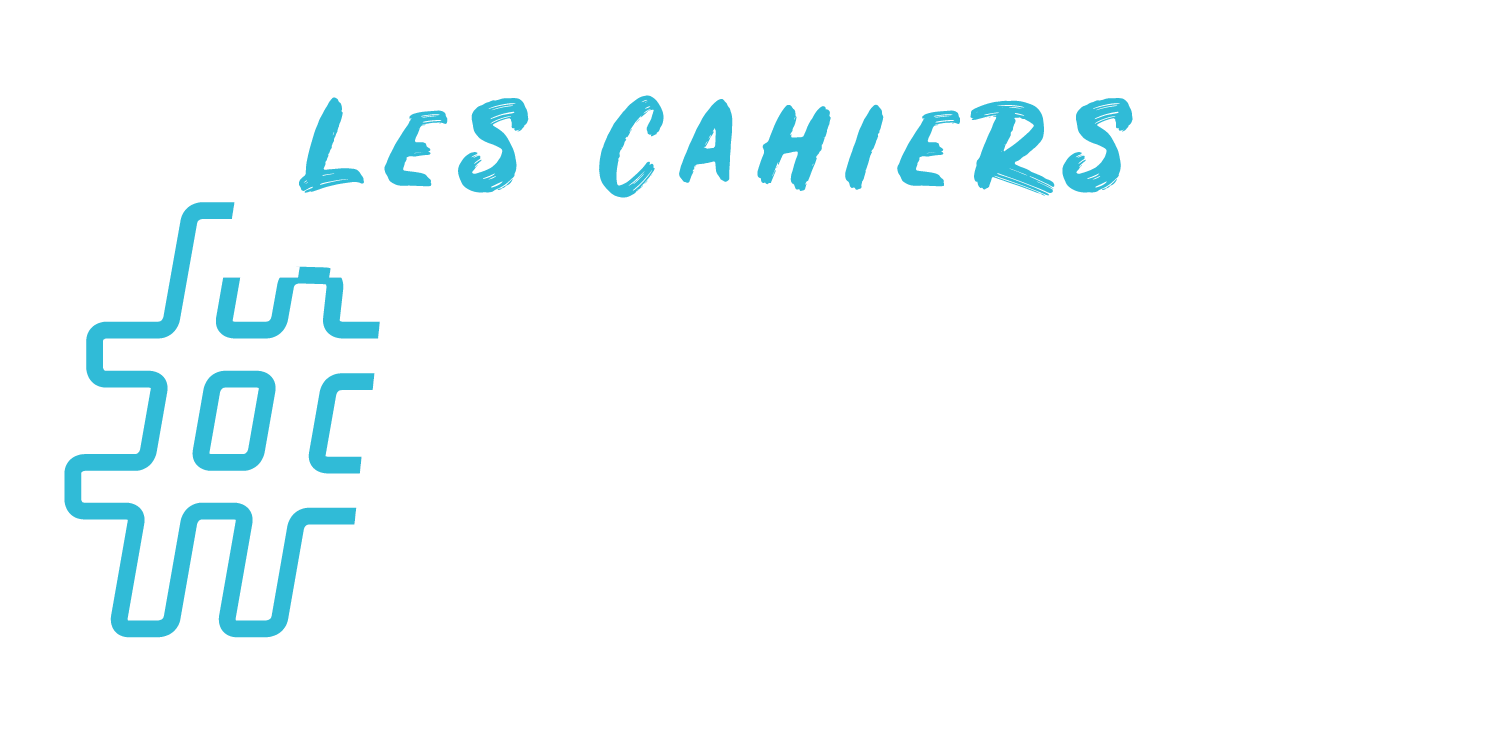Connexions Solidaires. Nos Cahiers présentent une enquête sur les politiques d’e-inclusion développées chez nos voisins anglais. Le constat est saisissant : au Royaume-Uni, numérique pour tous rime avec croissance économique et compétitivité, plutôt que solidarité. Est-ce une approche dont nous devrions nous inspirer ?
Benoît Thieulin. Non, je ne crois pas. Il s’agit d’un environnement différent et je ne pense pas qu’il faille limiter la révolution numérique à un enjeu purement économique. Certes, l’approche britannique est pragmatique, mais j’y perçois une sorte de retour en arrière par rapport à la « Big Society » que David Cameron avait envisagée. Le numérique y était un levier de transformation économique, mais aussi sociale. Or, je suis convaincu que la révolution que nous sommes en train de vivre, sous des coups de butoir plus ou moins violents, est une transition globale, qui change notre relation au savoir et, avant tout, aux autres. Au fond, nous vivons une révolution de « l’empouvoirement », le numérique redistribue des pouvoirs aux gens. Tout l’enjeu est de s’organiser pour que cette redistribution se fasse en direction de ceux qui en ont le plus besoin, aux personnes qui sont les plus éloignées du numérique.
CS. Dans nos cahiers, le GDS – le Government Digital Service – nous explique « qu’il n’y a aucun intérêt à développer des services dématérialisés de qualité, si les usagers n’ont pas la motivation, la confiance, les compétences et la connexion pour les utiliser. » Pensez-vous que l’on puisse poursuivre la dématérialisation des services publics, et privés, sans l’accompagner d’un travail sur la littératie ?
BT. Avec le rapport du Conseil National du Numérique sur l’inclusion numérique, nous avons voulu faire tomber la vieille lune de la fracture numérique, qui est une fracture de connexion et sur laquelle il ne faut pas se focaliser. Certes, le problème de la connexion des publics défavorisés existe, mais c’est un problème qui tend à se résorber. En revanche, nous devons anticiper les problèmes à venir, liés à la mauvaise maîtrise de cette connexion. En essayant de résoudre ces deux problèmes l’un après l’autre, nous risquons d’observer des écarts grandissants entre ceux qui ont la culture numérique – la littératie – et ceux qui ne l’ont pas. En effet, on peut très bien être connecté, mais ne pas être familiarisé avec cette nouvelle culture, ses nouveaux usages et ses nouvelles valeurs. Demain, un individu qui aura cette connexion internet, mais qui ne saura pas très bien se servir d’un réseau social professionnel, aura des difficultés à s’insérer dans le monde du travail. On ne peut donc pas se préoccuper de la connexion auprès de ces publics défavorisés en laissant de côté la question, beaucoup plus complexe, de l’enseignement de la littératie numérique.
CS. Emmaüs Connect prépare une étude sur ces décalages présents chez ceux qu’on nomme pourtant les digital natives…
BT. C’est très important, voilà un problème nouveau par rapport à ce qu’on pouvait imaginer il y a quelques années. Pendant longtemps, on a naïvement pensé que les digital natives – les individus nés avec le numérique – constitueraient une espèce de « génération spontanée » du numérique et de ses usages. En réalité, les digital natives sont de bons consommateurs du numérique, mais cela ne veut pas dire que ce sont des usagers éclairés, des citoyens d’une société numérique. Vous pouvez très bien savoir manier un jeu ou une application par exemple, sans pour autant savoir vous servir, encore une fois, d’un réseau social professionnel.
[boite largeur= »60% » position= »droite » citation= »1″]
Les digital natives sont de bons consommateurs du numérique, mais cela ne veut pas dire que ce sont des usagers éclairés, des citoyens d’une société numérique.
[/boite]
CS : Quel doit être le rôle du secteur privé dans la diffusion de cette littératie ?
BT. Sur ce sujet, je pense que la dichotomie entre secteur privé et secteur public est devenue, aujourd’hui, insuffisante. Il y a une zone intermédiaire, que l’on pourrait situer dans l’économie sociale et solidaire, qui prend peu à peu de l’importance. Je crois que nous allons progressivement sortir de l’ère des prestations égalitaires de masse, de ce que l’on aurait pu appeler les services publics industriels, financés, pour l’essentiel, par l’impôt et organisés par la puissance publique. Nous avons besoin de services plus ciblés, plus personnalisés, et qui ne peuvent pas s’organiser sur un mode industriel. Ces besoins vont donc être adressés par un autre service, souvent porté par les associations, et qui ne relève ni du secteur public, ni des entreprises, mais d’un secteur tiers qui allie la performance du secteur privé et la quête de sens. Dans ces nouveaux services, le rôle du numérique est de permettre l’outillage. C’est par son biais que s’opère la mise en relation, ainsi que la régulation, de ces nouveaux micromarchés non marchands, dont l’objectif n’est pas de verser des dividendes.
CS. A l’aube de la loi sur le numérique, et un an après la publication de l’avis du Conseil National du Numérique sur l’e-inclusion, peut-on tirer un premier bilan et évaluer l’impact qu’a pu avoir cette publication ?
BT. Pour l’instant, c’est un impact qui reste très politique et intellectuel. Notre premier objectif était avant tout de conscientiser un certain nombre d’acteurs, privés, publics et associatifs. Avec ce rapport, nous avons lancé le débat et mis un coup de projecteur sur des initiatives, des tendances, qui ne sont pas de l’ordre de l’État et qui, je l’espère, vont se généraliser. Espérons que la loi sur le numérique reprendra les recommandations poussées dans ce rapport, nous la nourrirons dans ce sens.